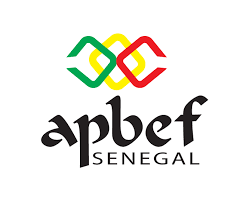Jeune Afrique - 27 novembre 2020
Par Achille Mbembe
Historien et politologue camerounais.
Des intellectuels africains répondent à Emmanuel Macron (1/3). Suite à l’interview accordée par le chef de l’État français à Jeune Afrique, le 20 novembre, plusieurs intellectuels ont souhaité lui répondre. Jeune Afrique a choisi de publier trois de leurs contributions.
Celles et ceux qui ont eu l’opportunité d’échanger avec le président Emmanuel Macron au sujet de la politique française en Afrique auront été frappés par sa pugnacité et sa vivacité d’esprit. Sa longue interview accordée à Jeune Afrique en aura cependant laissé perplexe plus d’un, en particulier celles et ceux qui étaient disposés à lui accorder le bénéfice du doute. Les sceptiques, en revanche, crient victoire. Dès le début, ils ont dénoncé l’effort consistant à faire passer une révision en profondeur des rapports franco-africains ce qui, à leurs yeux, n’était qu’une simple opération marketing.
À LIRE Exclusif – Emmanuel Macron : « Entre la France et l’Afrique, ce doit être une histoire d’amour »
Comment leur donner entièrement tort ? Flagrante absence d’imagination historique en effet. Aucune parole politique de poids. Pas un seul concept. À parcourir rapidement ces pages, l’on en ressort avec la ferme impression que la France n’aspire qu’à une chose, sur un continent dont elle s’accorde pourtant à reconnaître le rôle vital au cours de ce siècle. Faire de l’argent.
Cynisme et raison d’État
Mieux, faire de l’argent à la manière de la Chine et de son impérialisme froidement prédateur. La Chine, ce nouveau venu que l’on présente volontiers comme un repoussoir de jour, mais que l’on ne peut s’empêcher d’admirer à la nuit tombée, le dragon qui pille gaiement, et qui, sans s’encombrer d’on ne sait quelle mission civilisatrice, oblige les Africains à gager leurs sols, sous-sol et autres biens et à tout vendre, dans l’espoir de s’acquitter de colossales dettes dont le gros des montants aura été détourné par des élites vénales.
À LIRE « À bas la France ! » : enquête sur le sentiment anti-français en Afrique
Caricature ? À peine. Étonnement? Pas davantage. En maints endroits du monde, le libéralisme se conjugue désormais au nationalisme et à l’autoritarisme. Très peu d’États ou de régimes peuvent aujourd’hui mettre le poids d’une conduite exemplaire dans les remontrances qu’aux autres ils veulent faire. Pourquoi, dans la nouvelle course pour le continent, la France se priverait-elle d’avantages auxquels ses concurrents n’ont guère renoncé ?
IL SOUHAITE QUE SON PAYS FASSE PREUVE DU MÊME VIRILISME SANS QUE NE LUI SOIT RENVOYÉ À LA FIGURE SON PASSÉ COLONIAL
Emmanuel Macron souhaite que le France fasse preuve du même virilisme sans qu’à tout bout de champ ne lui soit renvoyé à la figure son passé colonial. Ou que lui soient chaque fois rappelés ses hypothétiques devoirs en matière de défense de la démocratie, des droits humains et des libertés fondamentales. Après tout, si les Africains veulent la démocratie, pourquoi n’en paient-ils pas eux-mêmes le prix ?
Prenons donc acte du fait que, constamment, le rapport des chefs d’État de la Ve République avec l’Afrique aura été avant tout motivé par des intérêts militaro-commerciaux. Dans ce domaine, ni l’âge ni l’écart générationnel ne jouent aucun rôle, sauf peut-être idéologique, comme aujourd’hui. Les sentiments non plus, qu’ils soient d’amour, de haine ou de mépris. Seule compte la raison d’État, c’est-à-dire un ou deux juteux contrats grappillés ici et là.
Vertigineuse perte d’influence
Si, dans ce monde de larcins, calcul froid et cynisme prévalent, qu’est-ce qui distingue donc Emmanuel Macron de ses prédécesseurs ? A-t-il, mieux qu’eux, pris l’exacte mesure de ce qui se joue effectivement, à savoir la vertigineuse perte d’influence de la France en Afrique depuis le milieu des années 1990 ? Que certains s’en désolent tandis que d’autres s’en réjouissent importe peu. Dans un cas comme dans l’autre, l’on a bel et bien atteint la fin d’un cycle historique.
La France ne dispose plus des moyens de ses ambitions africaines, à supposer qu’elle sache encore clairement en quoi celles-ci consistent. Étrangement, tant du côté africain que du côté français, le fantasme de la puissance persiste. Les uns et les autres continuent de penser et d’agir comme si la France pouvait encore tout se permettre sur un continent lui-même affaibli par plus d’un demi-siècle de gérontocratie et de tyrannie.
LE FRANC CFA N’EST TOUJOURS PAS ABOLI. LES RÉGIMES CORROMPUS NE CESSENT D’ÊTRE PLACÉS SOUS RESPIRATION ARTIFICIELLE
À sa manière, le président français a tenté d’infléchir le cours des choses. Mais il s’est bien gardé de débusquer le fantasme alors que c’est le fantasme qu’il faut liquider. Cherchant à relever le niveau d’attractivité de son pays, il s’est attaqué en priorité aux perceptions et a ouvert quelques chantiers peu coûteux, mais susceptibles de rapporter de beaux dividendes symboliques. Ainsi du projet de restitution des objets d’art conservés dans les musées français. Ainsi également de la Saison Africa 2020, dont plus de 50 % du budget provient de fonds publics, mais qu’il se gardera curieusement d’inaugurer lui-même tel que l’aurait voulu la tradition.
Entretemps, le Franc CFA n’est toujours pas aboli. Bien qu’usés, les régimes violents et corrompus ne cessent d’être placés sous respiration artificielle. Les opérations militaires se succèdent, même si, pour l’heure, elles se soldent surtout par une interminable métastase des groupes jihadistes et autres cartels de trafiquants et caravaniers.
À LIRE [Édito] Sahel : la guerre d’Emmanuel Macron
Avec ses milliers de soldats présents sur divers théâtres africains, l’armée est devenue, avec l’Agence française de développement, le principal pourvoyeur et consommateur de discours et de récits que des représentations françaises concernant le continent. Pour le reste, gestion des risques, notamment migratoires, et management à distance suffiront, pense-t-on.
A-t-on véritablement pris la mesure des contradictions qui ne cessent de s’accumuler ? Comment peut-on vider un contentieux dont on s’évertue à nier l’existence ou à minimiser l’importance ? A-t-on compris que loin d’être transitoire, le discrédit dans lequel la France est tombée est un phénomène structurel et multi-générationnel et non point le résultat de l’envoûtement victimaire de quelques ex-colonisés ?
Thèses anti-décoloniales
Aucun de ces défis n’étant pris à bras le corps, il n’est guère surprenant que les gestes qu’Emmanuel Macron prend pour de franches ouvertures dans un débat qu’il voudrait dénué de tabous, ouvert et « décomplexé » ne suscitent que peu d’intérêt chez celles et ceux auxquels il aimerait s’adresser.
Que sur des questions pourtant essentielles il se trompe souvent de diagnostic ne fait qu’aggraver les incompréhensions. Que gagne-t-on, par exemple, à plaquer des querelles franco-turco-russes sur le différend franco-africain ? Que dire des propos concernant la colonisation, cet autre aspect du litige ? Se méprendrait-on tant sur la nature exacte des rapports entre l’histoire et la mémoire, au point de prendre l’une pour l’autre, si le nécessaire travail de réflexion en amont avait été accompli et l’expertise en la matière mise à contribution ? Affirmer au Nord que la colonisation fut un « crime contre l’humanité » et au Sud qu’il s’agissait avant tout d’une « faute », c’est faire un pas en avant afin de mieux en faire deux en arrière.
ON PRÉFÈRE S’APPUYER SUR UNE MOUVANCE IDÉOLOGIQUE QUI A FAIT DE LA PEUR DE L’ISLAM SON FONDS DE COMMERCE
L’on serait tenté de passer outre de telles vétilles si elles ne révélaient pas la structure d’une pensée de l’Afrique dont les ressorts profonds sont à chercher du côté des thèses anti-décoloniales en vogue dans les milieux laïcistes et de la droite conservatrice. Alors que la France compte des experts de l’Afrique parmi les plus réputés au monde, l’on préfère s’appuyer sur une mouvance idéologique qui a fait de la peur de l’islam son fonds de commerce et du spectre du « communautarisme » sa vache à lait.
Comment comprendre autrement la démarche qui consiste à rabattre tous les déboires de la France en Afrique sur un prétendu panafricanisme de mauvais aloi dont on ne nous explique pas pourquoi il serait davantage dirigé contre cet ancien colonisateur plutôt que contre tous les autres ?
À LIRE [Tribune] Emmanuel Macron, l’islam et les risques d’amalgames
Prétendre en outre que la critique du racisme fait le lit du « séparatisme » vise peut-être à donner quelques gages aux idéologues de la droite conservatrice, voire de l’extrême-droite et aux nationalistes de tous bords. Mais hors-l’Hexagone, de telles affirmations ne sont pas seulement incompréhensibles. Elles font fi de l’apport intellectuel des Africains et de leurs diasporas au discours universel sur l’émancipation humaine et n’aident en rien à l’analyse et la compréhension des enjeux franco-africains contemporains.
Une parole à peine audible
En réalité, la France et les tyrans africains qu’elle aura soutenu à bout de bras depuis 1960 sont les premiers responsables de son discrédit auprès des nouvelles générations. Le cycle néocolonial ouvert par le Général de Gaulle lors de la Conférence de Brazzaville en 1944 aura fait long feu. Mis en pratique dans la foulée des décolonisations formelles, il est à bout de course. Il a perdu ses principaux ressorts au sortir de la guerre froide, lorsque la France a livré ses « provinces africaines » pieds et poings liés aux diktats des institutions de Bretton-Woods et a entamé son propre tournant néolibéral.
Sans nécessairement brûler les vaisseaux, l’ancienne puissance tutrice n’a eu de cesse, depuis lors, de se dessaisir elle-même de ses principaux atouts sur le continent, libérant au passage des dynamiques de désapparentement qu’elle ne parvient plus à juguler. La hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers, dont près de 45 % venaient d’Afrique, en est une frappante illustration. Au même moment, la Chine en accueille près de 80 000.
À LIRE Algérie : pourquoi l’interview d’Emmanuel Macron irrite
Rien, pour le moment, n’indique que l’hémorragie ait été stoppée au cours des quatre dernières années. Au contraire, le tableau est plus que jamais contrasté. Si parole politique il y a, elle est à peine audible. Analyse et prévision sont tombées dans la besace des corps expéditionnaires. Le Conseil présidentiel pour l’Afrique agit davantage comme une organisation non gouvernementale que comme un foyer de réflexion prospective.
Le choix des diasporas comme bras civil d’une croisade pro-entreprise ne semble reposer sur aucune réalité sociologique avérée. Au contraire, il risque d’aviver la course aux rentes et les penchants affairistes là où la priorité devrait être au renforcement des capacités culturelles et sociales des communautés et à la protection des libertés fondamentales.
Transformer l’imaginaire africain
Il se pourrait qu’aux générations d’aujourd’hui et de demain, la France n’ait finalement rien d’autre à proposer qu’un bon vieux pacte. Les Africains s’engageraient à oublier volontairement le passé colonial. À la place, ils cultiveraient assidûment un nouvel ethos, l’amour des affaires et une passion du lucre prestement rebaptisées au fronton de l’« entreprenariat » et du militarisme.
LE CAPITAL SOCIAL, INTELLECTUEL ET ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE EN MATIÈRE AFRICAINE EST EN PASSE D’ÊTRE DILAPIDÉ
Tel n’est toutefois pas le seul chemin possible. Emmanuel Macron en est lui-même persuadé, pour que change le paradigme, il ne suffit pas de modifier le style. Il faudra reconstituer de véritables capacités d’analyse historique et prospective. Il faudra surtout, alors qu’ils sont tentés de se recroqueviller sur eux-mêmes, transformer en profondeur l’imaginaire africain des Français. Un tel travail politique et culturel de long terme ne peut se faire qu’indépendamment des contraintes du calendrier électoral.
De tous les pays européens, la France dispose du capital social, diplomatique, intellectuel, artistique, économique et scientifique le plus riche en matière africaine. De mille et une bonnes volontés également. Que l’on en arrive à un point où le mirage chinois, affairisme mâtiné d’autoritarisme et de militarisme, constitue la seule alternative offerte aux générations africaines montantes montre avec quelle force ce capital multiforme est en passe d’être dilapidé, et l’imagination historique émasculée.